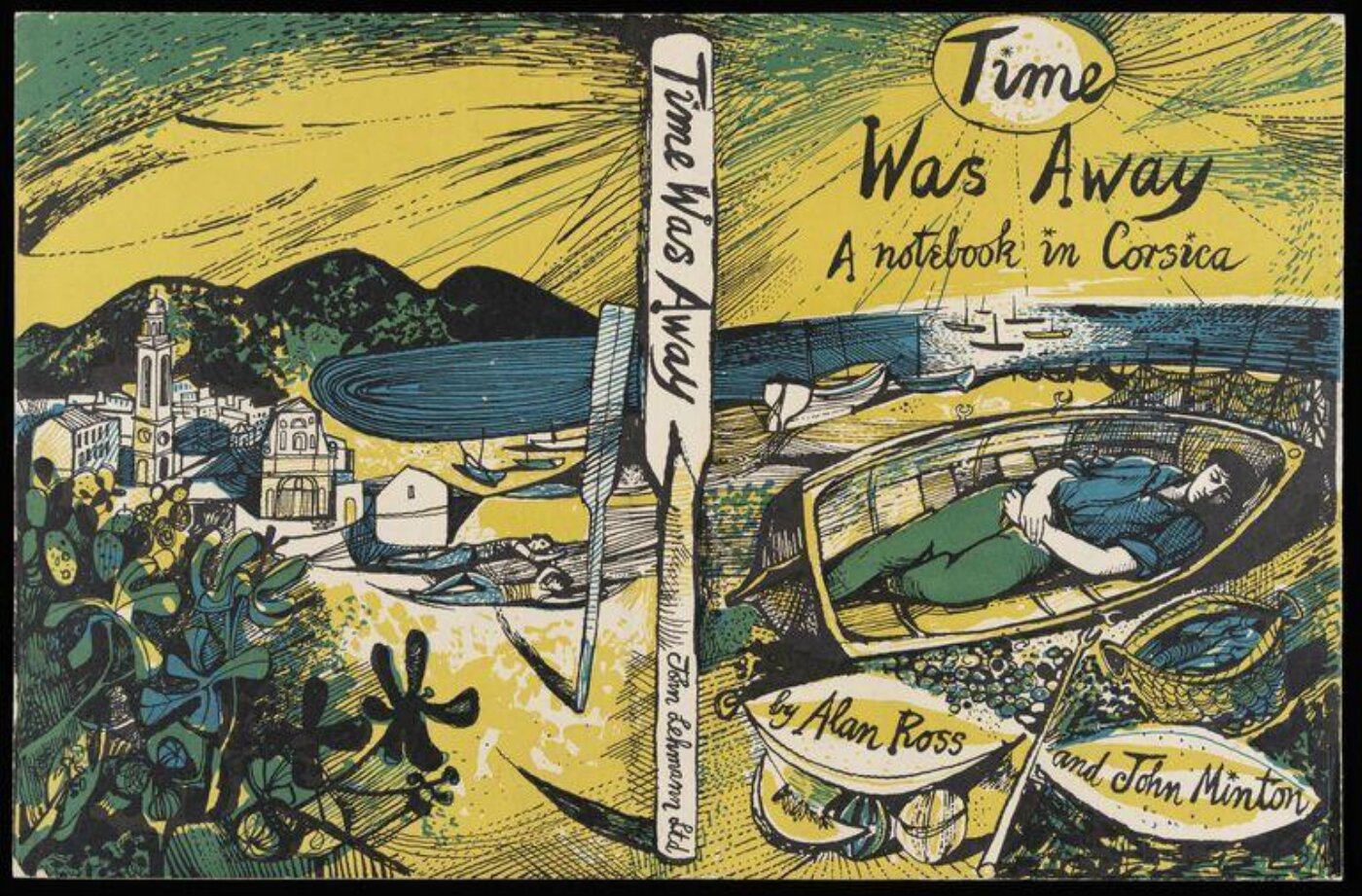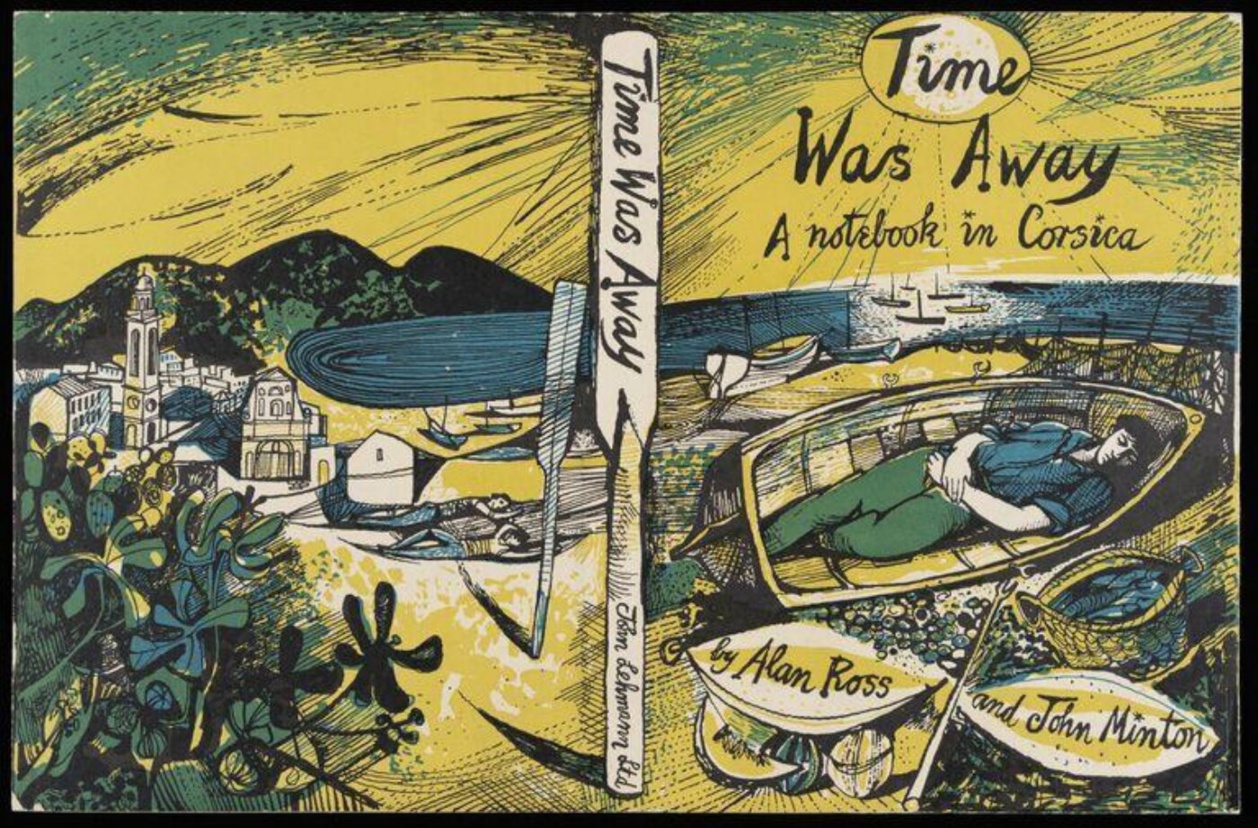Depuis longtemps une question me brûle la langue : suis-je encore moi-même lorsque, quittant parfois mon territoire, poussé par la curiosité, je parcours un autre espace, rencontre d’autre gens, goûte d’autres saveurs, entends d’autres chants ? Suis-je encore moi-même ou suis-je devenu un touriste, c’est-à-dire un de ces individus généralement habillés – et parfois si peu – d’étranges costumes dont on sent bien qu’ils ne leur sont pas habituels et qui, se déplaçant en hordes, ne respectent ni les lieux ni les gens quand ils estiment qu’il y a une photo à prendre ? Suis-je devenu, en somme, insupportable ?
Mais je sais que rien ni personne ne m’attachera comme un chien à la niche, et que la pulsion atavique du voyage m’entraînera de nouveau. Alors je t’interroge : comment puis-je devenir un voyageur sans me transformer en touriste ?
Cette question est récurrente en sociologie du tourisme et elle en appelle naturellement une autre : depuis quand touriste et voyageur sont-ils devenus des « frères ennemis »[1]?
À l’origine était le voyageur dont la motivation n’était que rarement le loisir mais plutôt le commerce voire un déplacement à des fins militaires chez les Romains. Voyage vient de « viaticum » : l’argent ou les provisions pour la route, « viatique » qui, par extension, s’appliquera au voyage dans l’au-delà…
Le touriste arrive bien plus tard : deux mille ans séparent le voyageur antique des premiers touristes du XVIIIe siècle, jeunes aristocrates anglais qui effectuaient un Tour d’Europe, petit ou grand, pour parfaire leur éducation.
La cohabitation entre le voyageur et le touriste commence donc par un paradoxe : ces premiers touristes en quête de sens sont en réalité plus proches de ce que nous qualifierions aujourd’hui de voyageurs. Mais la rupture véritable entre ces deux manières d’être au monde des migrations individuelles ou collectives, viendra avec l’accès des masses au temps libre et aux déplacements.
C’est dans les années 1950 que plusieurs facteurs, dont le développement des liaisons aériennes avec des avions gros porteurs, permettront l’émergence d’une nouvelle forme de tourisme : le tourisme dit de masse. Sous cette appellation parfois galvaudée, se constitue en fait un nouveau modèle économique dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Une sur-représentation des investissements extérieurs,
- Des structures d’accueil de grande capacité (100, 200 … 400 lits !),
- Une évasion de la valeur ajoutée (puisqu’il s’agit d’investisseurs extérieurs),
- Un rôle prépondérant du tour operating.
C’est cela le « tourisme de masse », un système qui caractérise le fonctionnement de certaines destinations touristiques où le tour-opérateur est le maître du jeu. À ne pas confondre, à l’instar de nombreux journalistes, avec des questions liées à la sur-fréquentation, phénomène planétaire et consubstantiel à l’activité touristique, simple rançon de l’attractivité aujourd’hui dopée par des moyens numériques dits sociaux. Une destination n’appartenant pas au modèle économique du tourisme de masse peut être victime de sur-fréquentation sur certains de ses sites et sur certaines périodes de l’année.
L’univers du tourisme de masse a été largement étudié par les sciences sociales, il a également été l’objet d’œuvres de fictions emblématiques parmi lesquelles la trilogie des « Bronzés » occupe une place importante dans l’inconscient collectif d’une génération de touristes français. Gilbert Trigano avait d’ailleurs reconnu que la sortie du premier opus avait eu un impact négatif sur la fréquentation du Club Méditerranée : effet miroir, prise de conscience de clientèles ne souhaitant pas être assimilée à ces archétypes où le sympathique côtoie le pathétique.
C’est ici que commence l’ambiguïté décrite par Sylvie Brunel en ces termes : « Le tourisme transforme une partie de la planète en un immense parc d'attractions. Un Disneyland grandeur nature … Faut-il s'en affliger ? Pas forcément : nous sommes tous des touristes, un jour ou l'autre, même si nous nous en défendons. » [2]
Certes, mais, pour des raisons diverses, nous n’avons pas envie d’être assimilés à ces foules, ces hordes photographiées avec malice par le britannique Martin Parr [3], parce que ces images ont le goût d’un rêve frelaté, sorte d’ersatz de nos représentations du voyage véritable sensé ne pas reproduire les schémas de la vie quotidienne. En général nous n’avons pas envie de ça mais, et cela en est peut-être d’ailleurs la cause, nous sommes obligés de reconnaître que nous avons fait au moins une fois l’expérience de cet « idiot du voyage » dont Jean-Didier Urbain [4] s’est fait l’avocat : ce mauvais voyageur qui, comme l’enfer, est toujours l'autre.
Cette dualité voyageur-touriste est décrite et cultivée depuis longtemps par les élites intellectuelles, de Stendhal à Lévi-Strauss en passant par Stefan Zweig qui l’avait traduite dans une opposition entre le voyageur et le « voyagé ». On pourrait imaginer une échelle de la mobilité de loisir avec à chacune de ses extrémités le voyageur et le touriste et entre les deux une diversité de types se rapprochant de l’un de l’autre en fonction des circonstances.
À dire vrai, peu d’individus pourraient se réclamer de ce « haut de l’échelle » qu’est le voyageur, cet aristocrate du déplacement adepte de Nicolas Bouvier [5] et qui comme lui affirmerait : « …c'est surtout le nombre incalculable de rencontres, de portraits, de descriptions de mœurs et de coutumes, qui retient l'attention. L'altérité humaine constitue à n'en pas douter l'un des éléments clés … ». Il faut rester modeste …
De l’autre côté de l’échelle, les touristes, assumés ou pas, sont naturellement plus nombreux car pendant longtemps ils se sont contentés de chercher un endroit où passer des vacances pendant lesquelles leur objectif était de ne rien faire [6] alors que le voyageur cherche à vivre une aventure, voire un rêve libertaire. "Vacance", après-tout, est synonyme de "vacuité".
Cette tendance de fond des années 1990-2000 aurait muté au cours des années 2010-2020. Le tourisme étant aussi un fait générationnel, de nouvelles clientèles constituent désormais une demande croissante pour pratiquer un tourisme dit « expérientiel ».
Comme toujours, le marketing s’empare du sujet avec pour objectif de procurer un sentiment d’exception au consommateur, lui laissant croire qu’il n’est pas un touriste mais un voyageur. Cette propension du marketing à vouloir convaincre le consommateur qu’il est unique et sera traité comme tel n’est d’ailleurs pas une spécificité du tourisme : échapper à la masse est une aspiration commune dans de nombreux domaines de la consommation.
On observe qu’il existe désormais un champ du possible entre tourisme expérientiel et puristes du voyage, des initiatives ont vu le jour qui consistent à emprunter à la démarche du voyageur : se sentir un habitant plutôt qu’un visiteur, se perdre plutôt que suivre des balises, … La démarche et la devise des Greeters : « Venez en visiteur, partez en ami » est assez emblématique de cette tendance : il s’agit d’être accueilli par des habitants bénévoles qui font découvrir leurs lieux comme ils le souhaitent à des personnes qui ne veulent pas d’une proposition commerciale formatée. Lynn Brooks, fondatrice des Greeters à New-York en 1992 illustre cette démarche de la façon suivante : « La visite touristique ne doit pas se limiter à un acte de consommation. »
Finalement, ce type de démarche existe depuis longtemps sous diverses formes si l’on songe que le routard qui donna naissance au célèbre guide est une sorte de voyageur libertaire fuyant les sentiers battus. On l’aura compris, désormais la dichotomie voyageur-touriste est faite d’une frontière poreuse qui a vu l’émergence d’un hybride dont le patrimoine génétique est constitué des deux souches. Pour être intellectuellement viable, ce métis pourrait ne satisfaire qu’à un seul principe : celui par lequel le départ ne vaut que par le retour, le retour qui engage une réflexion sur soi et sur son espace de vie retrouvé.
[1] Selon une expression empruntée à Bertrand Lévy, « Voyage et tourisme : malentendus et lieux communs » in Le Globe, Revue genevoise de géographie, tome 144, 2004.
[2] La planète Disneylandisée, Sylvie Brunel, Editions Sciences Humaines, 2006.
[3] Petite planète, Martin Parr, Hoëbeke, 2008.
[4] L’idiot du voyage, Jean-Didier Urbain, Payot, 2002.
[5] L’usage du monde, Nicolas Bouvier, La Découverte poche, 2014.
[6] L’étude et le rapport « Réinventer les vacances » publié en 1998 à la demande de la direction nationale du Tourisme, avait mis en exergue le fait que la principale activité des vacanciers était de ne rien faire du tout. Même si cette publication date un peu, gageons qu’elle exprime une certaine permanence du comportement vacancier.
Tonì Casalonga :
Puisque tu as, cher Jean-Louis, en répondant à mes interrogations aiguisées encore plus ma curiosité, il me vient à l’esprit de t’interroger à propos de cet être hybride. Non seulement je m’y reconnais, mais je le rencontre presque tous les jours dans mon village qui est devenu, en partie par la volonté de ses habitants, une « destination » touristique.
Mais il se trouve qu’en y réfléchissant bien je crois trouver une troisième composante à cet hybride, si j’observe la microéconomie qui m’entoure. Quand je le vois repartir, une fois le paysage et le climat consommés et les photos faites, chargé de sacs contenant des objets et des denrées qui pour la plupart ont été produits sur place, ou tout simplement repus après un bon repas lui aussi composé de denrées de base provenant en majorité du « circulu » villageois, je me demande si cette hybridation ne comporte pas une troisième part… Quand il retourne chez lui, ce qu’il emporte, dans son sac ou dans son estomac, cela ne suffirait-il pas, en somme, à faire de lui l’agent actif d’un processus d’exportation ?
Car si on mesure le dynamisme d’une économie en partie à sa capacité d’exporter sa production, nous avons là une sorte de perfection puisque le producteur voit son produit, non seulement faire l’objet d’un achat extérieur, mais en plus le client se charge du transport, parfois de l’emballage et même des formalités d’exportation quand il y en a ! Cette troisième partie, que l’on pourrait en quelque sorte qualifier d’exportation sur place, n’est-elle pas l’élément fondateur d’une économie du tourisme grâce à laquelle le territoire et ses habitants pourraient supporter la charge des nuisances que génère la porosité que tu soulignes ?
Jean-Louis Moretti:
Oui, bien sûr, n’en déplaise à quelques économistes chagrins, le tourisme génère bien des « exportations sur place ». Sinon, comment nommer ce fait ? Surtout si l’on s’en tient à la définition donnée par l’Insee : « Les exportations de biens et de services sont des opérations (ventes, troc et dons) par lesquelles des résidents fournissent des biens et des services à des non-résidents. Pour qu’il y ait exportations, il faut qu’il y ait changement de propriété entre résidents et non-résidents. » [1]
Nous sommes objectivement en présence de biens produits localement et achetés par des agents économiques de passage les emportant chez eux, loin du lieu de production, quelque part en Europe. De surcroît, quitte à périr sous les foudres définitives des économistes déjà évoqués, pour la majorité des biens que tu cites, il s’agit d’exportation sur circuits-courts : nous venons certainement d’inventer un autre hybride…
Cela dit, puisque nous évoquons l’apport de devises extérieures qui caractérise l’effort de tout pays souhaitant équilibrer sa balance des paiements, il faut aussi avoir à l’esprit que cet apport peut s’inscrire dans une démarche mortifère : celle des stratégies de « devise-lit » selon une formule du géographe et ami de la Corse Jean-Pierre Lozato-Giotart [2]. Ce type de stratégie, qui a été observée à grande échelle sur la rive sud de la Méditerranée, consiste à créer toujours plus de lits pour faire rentrer des devises extérieures, et à plus forte raison si le taux change entre les monnaies, génère un gros multiplicateur.
L’hypertrophie de la capacité d’accueil touristique va d’abord créer de la richesse autour d’une vague immobilière qui se révélera ensuite être un piège pour le développement touristique de la destination et pour le développement en général : problématique des lits froids, standardisation de l’offre, irréversibilité du modèle économique, nuisance environnementales, concurrences foncières, éviction de la population locale pour l’accession au logement, dérives mafieuses car l’immobilier, comme les déchets, est un domaine fieffé de ces prospères ONG.
L’écueil en matière de développement économique c’est l’aliénation, en l’occurrence celle d’un patrimoine foncier et immobilier, c’est pour cela que le PADDUC prône une « économie productive » : sans production point de salut mais la production nécessite des outils de production que les territoires n’ont pas toujours les moyens de financer. À cet égard, il est peut-être intéressant de rappeler que la Corse, même si elle n’en est pas forcément bien consciente, s’est doté d’un modèle de développement touristique singulier : un modèle « sui generis » parmi les destinations touristiques et plus encore si l’on traite des destinations insulaires.
Fruit de résistances sociales lors des années terribles de l’aménagement à grande échelle du littoral, le modèle Corse a ceci d’original qu’il se caractérise par une maîtrise quasi-complète de l’outil de production par la population locale : les Corses. C’est un fait inédit lorsque l’on sait que l’outil de production hôtelier est extrêmement capitalistique et qu’un territoire qui s’ouvre au tourisme fait toujours appel à des investisseurs extérieurs. Même Fidel Castro ouvrit Cuba aux chaînes hôtelières internationales dans les années 1990 pour faire entrer des devises rapidement afin d’affronter la crise consécutive à l’effondrement de l’URSS.
Le fait que la Corse n’ait pas été confrontée, à l’instar de nombreux pays du Sud, à ce type d’urgence économique, lui a permis de choisir le type de développement qu’elle souhaitait. Ce développement touristique endogène qui produit des « exportations sur place » et qu’elle a officialisé en 2015 en gravant dans le marbre du PADDUC les quatre commandements suivants : « Un tourisme durable, fondé sur l’identité, largement réparti sur l’année et sur les territoires » [3].
[1] Définition du Système Européen des Comptes nationaux et régionaux de 2010 (SEC 2010), basée sur le changement de propriété en cohérence avec la 6e édition du manuel de balance des paiements (BPM6).
[2] Le chemin vers l’écotourisme, Jean-Pierre Lozato-Giotart, Delachaux et Niestlé, 2006.
[3] PADDUC, PADD, Orientation Stratégique n°5.