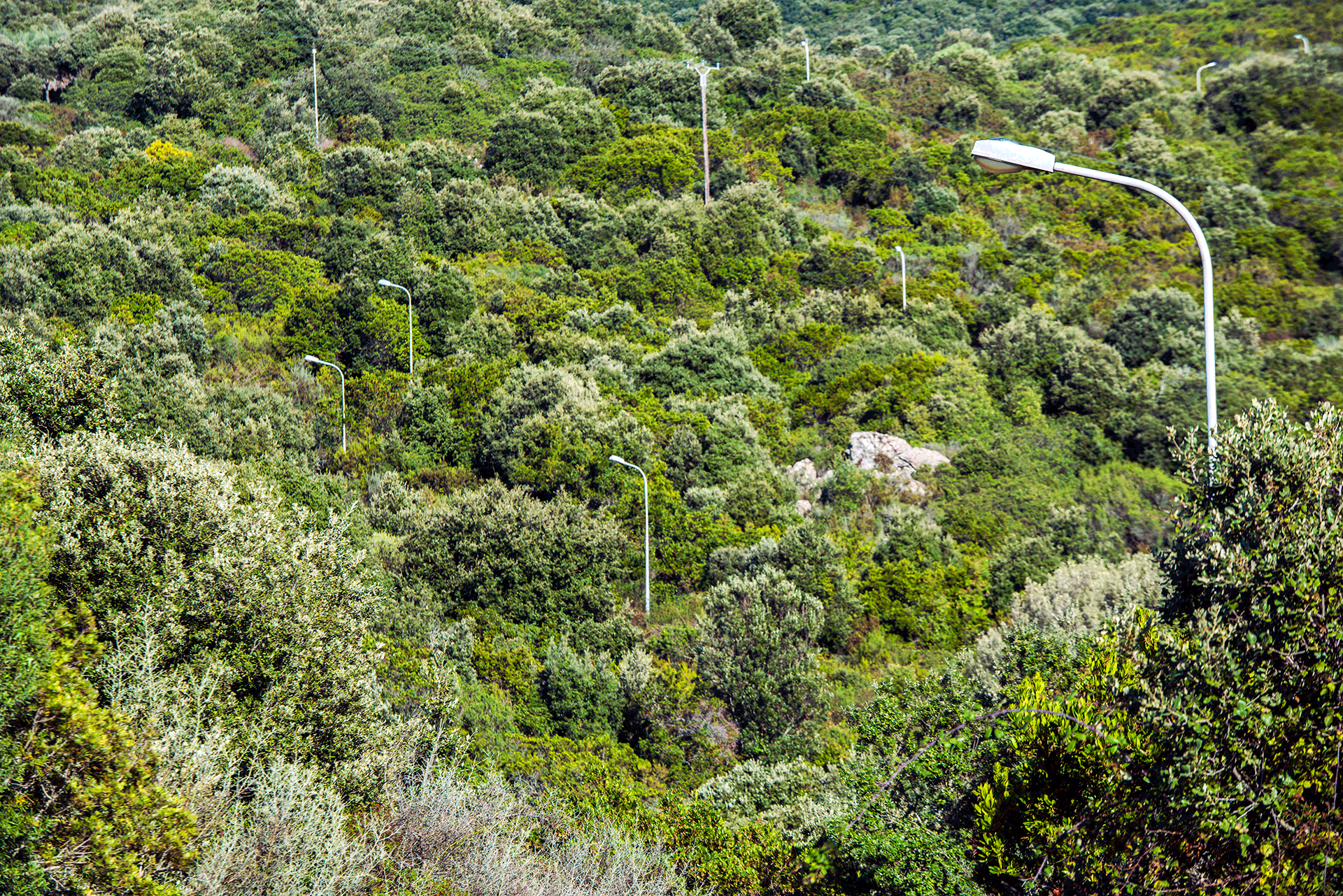Jean-Michel Sorba
Ti mandu un articulu di Catherine Larrère, a filosofa [1]. Cume materia da rifletta... Eccu l’argumentu di l’articulu : « le changement climatique est à la fois la cause du renforcement des inégalités sociales et environnementales, et l’effet de ces inégalités et de leur échelle. Ne pas engager la transition écologique revient à maintenir et aggraver une injustice dont souffrent les plus défavorisés. »
Ti mandu un articulu di Catherine Larrère, a filosofa [1]. Cume materia da rifletta... Eccu l’argumentu di l’articulu : « le changement climatique est à la fois la cause du renforcement des inégalités sociales et environnementales, et l’effet de ces inégalités et de leur échelle. Ne pas engager la transition écologique revient à maintenir et aggraver une injustice dont souffrent les plus défavorisés. »
Tonì Casalonga
Car’amicu, à première lecture ce texte est décourageant, quand on apprend avec accablement que « le changement climatique et les autres dérèglements écologiques associés, en modifiant les milieux de vie, renforcent les inégalités existantes, et en font apparaître de nouvelles », comme si les anciennes (?) ne suffisaient au malheur des pauvres !
Mais en poursuivant la lecture, peu à peu j’ai changé d’avis et j’y ai trouvé un encouragement à la fois à la vertu individuelle et à la responsabilité civique. Car si elle nous rappelle que « la sobriété ne se réduit pas aux conduites individuelles », elle affirme que la mise en place des solutions par une politique publique est une nécessité. Parce que, en effet, « on se représente la transition écologique comme un effort de l’État pour venir à bout des résistances d’une société civile arc-boutée sur ses intérêts particuliers. De fait, c’est tout le contraire qui se produit ». Et partout naissent des Greta Thunberg…et des Levante.
Puis elle ajoute, comme un rappel aux citoyens que nous sommes, que « c’est d’abord le rôle des politiques publiques de mettre en place les solutions nécessaires pour que les activités essentielles au bien-être de tous se déroulent dans le respect des limites planétaires ». Ce qui nous ramène à notre île, et aux deux enquêtes publiques en cours et à la position de nos élus dont on peut se demander s’ils sont à ranger dans ce qu’elle nomme le technosolutionnisme, ou dans le populisme écologique ?
Jean-Michel Sorba
Je prolonge ce que tu dis en ajoutant que les premières victimes sont également celles dont les moyens d’expression sont les plus faibles. Un quart-monde insulaire qu’il convient d’intégrer avant que ne surgisse un mouvement social impuissant face aux enjeux écologiques. Larrère précise dans le texte que l’opposition entre « fin du monde et fin du mois » est une alternative trompeuse. Si rien n’est fait, les fins du mois vont être d’autant plus dures pour les pauvres que les conditions d’existence vont se dégrader.
La désorganisation déclenchée par le Covid est riche d’enseignements. Le dérèglement climatique, ses conséquences, et les tensions politiques se renforcent et leurs effets sont d’ores et déjà perceptibles dans les domaines de l’alimentation, de la mobilité, de l’énergie et du logement. À titre d’exemples, il est fort probable que les limitations de l’usage de la voiture ou encore de la climatisation vont contraindre fortement notre vie quotidienne.
Comme tu le notes, Larrère nous met en garde contre le technosolutionnisme. « Compter sur le technosolutionnisme (technologies innovantes, renforcement du nucléaire) pour accomplir une transition énergétique prétendument indolore qui se ferait presque à l’insu des consommateurs dont les habitudes seraient inchangées, est à la fois hypocrite et de mauvaise foi. Cela relève de ce que l’on peut qualifier de populisme écologique. » Il faut entendre ici la croyance selon laquelle la technique peut résoudre mécaniquement des dérèglements essentiellement biologiques.
L’indispensable bifurcation de nos vies vers plus de sobriété fait partie intégrante de la réussite des transitions. Mais il faut s’entendre sur le terme. Il ne s’agit pas de réduire unilatéralement et uniformément les capacités de tous et avec la même intensité. Larrère propose plutôt des changements organisationnels favorisant les usages collectifs des moyens et des infrastructures. « Pour que le bilan carbone global des voitures électriques soit positif, il faut augmenter leur temps d’utilisation, ce qui impliquerait un usage collectif plutôt qu’individuel, avec ce que cela suppose de modifications dans l’urbanisme et dans les modes de vie ». Ce qui est sûr c’est que la technologie ne peut tenir la place quasi miraculeuse, le remède à tous nos problèmes, celle qu’elle occupait durant les Trente glorieuses, années sans limites.
Tonì Casalonga
En substance c’est également ce que dit la députée européenne Marie Toussaint : « Si nous appelons avec force à ré-encastrer notre économie dans les limites planétaires et à reconnaître les droits de la nature, c’est avec un objectif premier : celui de garantir pour chacune et chacun le respect, la dignité, la vie, tout simplement ». N’est-ce pas là, en quelques modestes mots, défini concrètement ce que Saint-Just en son temps qualifiait d’idée nouvelle, le bonheur ?
C’est là qu’il est indispensable d’avoir une idée claire de la situation objective de notre île, qui n’est certes pas à ranger dans les zones du monde les plus démunies mais plutôt à considérer comme une société pauvre parmi les riches, la Corse est à un moment de basculement de son histoire. Car, dit Catherine Larrère, « il est essentiel pour les populations les plus défavorisées et les plus fragiles de réinscrire leurs modes de vie et leurs activités économiques dans leurs préconditions sociales et vitales tant humaines qu’environnementales ». Tocca à noi à fà la.
Jean-Michel Sorba
Tout à fait, plus fondamentalement, Catherine Larrère nous invite à reconsidérer nos manières d’habiter et le message s’adresse à tous les habitants de notre île. « Le changement climatique transporte vers les milieux de vie l’attention jusque-là portée à la seule quantification des différences de revenu et de patrimoine. Ce n’est pas seulement la faiblesse ou la précarité des revenus qui compte, c’est aussi la dépendance par rapport aux conditions de vie. » Il nous faut sans démagogie réviser le sens donné à la richesse et à la pauvreté. Nous sommes trop habitués à réduire le progrès social au pouvoir d’achat ; c’est une facilité et un trait de l’histoire des dernières décennies. Cela revient à limiter l’existence humaine aux pratiques consuméristes. Si l’on excepte la partie de la population la plus pauvre, les Corses devront renoncer à un style de vie centré sur la consommation pour réapprendre à habiter collectivement et individuellement leur(s) milieu(x) de vie.
Les crises diverses à venir liées au changement climatique élargissent le champ de ce que doivent devenir nos préoccupations. C’est notre bien-être qui se trouve réinterroger. De ce point de vue, je ne suis pas sûr que le bien-être des Corses se soit amélioré ces 40 dernières années... Ou plutôt, je pense que ce qui nous liait à la Corse est en totale recomposition, parfois dans la douleur nos relations se transforment...
Le fait que les situations écologique et sociale se dégradent ensemble au moment même où la question de l’autonomie de notre île est à l’agenda ne doit pas être perçu comme une péjoration. Nombreux sont ceux qui pensent que la région est la bonne échelle de conception et d’opérationnalisation des politiques de transition. Mieux, dans le cas des îles, leur efficience dans les domaines de la mobilité (la ville), de l’énergie (choix des sites), de l’alimentation (relocalisation) ou encore de la santé (proximité des soins) milite pour un surcroit d’autonomie. La crainte, bien compréhensible en temps de crise, que l’autonomie se traduise par une régression sociale peut être interprétée comme une surévaluation des capacités de l’Etat-providence à faire face à des prérogatives inédites, un "quoi qu'il en coûte" écologique et/ou une forme de sous-évaluation des impacts écologiques.
C’est bien là que réside l’équation nouvelle que posent les crises à l’exécutif régional et d’une façon générale aux habitants. Reprendre possession de nos conditions d’existence par l’autonomie est le défi majeur que pose la crise. L’histoire est là pour prouver aux Corses que de nombreuses possibilités d’action existent en dehors du cadre de politiques publiques centralisées.
Tonì Casalonga
Les habitants, dis-tu, et plus loin tu les nommes « Corses ». N’est-ce pas dans ce glissement que se situe la complexité de la notion d’habitation ? Il me semble me souvenir d’un vers de Yeats, qui disait à ce propos que les Irlandais sont ceux qui sont habités par l’Irlande…
Jean-Michel Sorba
La notion d’habiter est intéressante mais également exigeante ! Elle est prometteuse quand elle nous recentre dans la réalité matérielle de la Corse d’aujourd’hui. Elle est fructueuse si elle ne fait pas violence aux traces des anciennes « habitations », j’entends par là les anciennes manières d’habiter les territoires. Ce serait folie que de s’adonner à une forme de présentisme oublieux des savoir-être, des savoir-faire, en un mot de la culture des lieux et des milieux. Chaque Corse ressent, je pense, plus ou moins consciemment, le besoin de se (re)connecter à la réalité de notre terre.
Un désir contrarié par l’individualisation consumériste que l'on observe en Corse comme ailleurs. Pour le pire, car les anciennes solidarités sont largement érodées alors que celles qu’il nous faut tisser face aux crises ne sont pas encore là. Pour la bonne part, lorsque l’habiter contemporain rend possible l’accomplissement personnel, celui d'une individuation libéré du poids des dépendances communautaires. À mon sens, les crises appellent – dans l’urgence – de nouvelles solidarités qui ne peuvent se réduire à un partage des points de PIB.
Une recomposition identitaire est en cours, construite et plurielle. En Corse comme ailleurs, elle se fait selon plusieurs appartenances, sociale, professionnelle, culturelle, etc. C’est donc par une coupable facilitée qu’il m’arrive d’assimiler l’identité collective (celle dont je prétends qu’elle est en cours de dislocation - dys-location? - pris au sens de délier des lieux qui la constituent) au bricolage individuel que nous sommes amenés à faire les uns et les autres. Deux manières de tenir droit (ou pas trop courbé/penché) autant qu’on le peut le faire.
Cette facilité-là pointe l’ambivalence de la notion d’identité, une ambivalence largement exploitée en Corse (et ailleurs) à l’origine d’un ressentiment où l’identité collective se nourrit trop souvent des frustrations, des échecs et des désamours individuels et finalement de peu de chose de la vie collective concrète. Cette pseudo-identité collective fonctionne trop souvent pour tenir la face collectivement, un masque pour éviter quelquefois l’effondrement individuel produit par le chambardement de la globalisation et des ses déconstructions. Une manière de « s’accrocher aux branches » des peuples sans avenir, dont l’expression se limite aux "votes identitaires" en Europe ou dans le sein des religions (les affres de l’islam radical en fournissent un exemple).
Le manque de « matière au travail » en est pour moi la raison principale. Même à l’usine le travail était le gage d’une santé collective parce qu’il engendrait la révolte, la politique (l’esprit de classe) et l’intérêt pour la cité. Vidées de matière et donc d’esprit, ce sont des identités collectives en errance qui prennent possession d’une vie publique devant laquelle s’efface le bien commun et l’intérêt de la Cité.
L’urgence pour que le peuple Corse se recompose (y compris politiquement) selon des modalités configurées par les nouveaux enjeux, dont certains sont inédits dans l’histoire de la Corse et plus largement de sapiens (!) est de reprendre maille avec la matérialité de l’île. Pas d’autres alternatives que celle-là. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir agriculteurs, villageois ni même ruraux bien sûr mais nous nous devons tous de vivre aux dimensions de notre île, de ses possibilités naturelles, de ses capacités matérielles et relationnelles, des désirs de ses habitants, urbains et villageois. Aucune identité collective ne peut s’édifier en déniant la crise en cours. La fiction d’un retour au passé se heurte aux réalités de nos existences, aujourd’hui urbaines, peuplées d’artefacts technologiques qu’il nous faut maitriser.
Tonì Casalonga
Que la « robustesse des réponses se manifeste là où le global est localisé » ne peut en effet se concevoir et mettre en œuvre que dans une démarche de planification locale. Pour que cette démarche ne soit pas (que) technocratique, tu souhaites qu’elle soit participative. Je suis bien sûr d’accord, même si je préfère l’adjectif « contributif », plus dynamique. Mais je dois te dire amicalement que je suis en désaccord avec toi quand tu dis que « l’identité corse [est] de moins en moins partagée ».
Jamais le désir d’identité n’a été aussi grand ni aussi partagé, y compris dans le refus, jamais elle n’a autant été une recherche parfois désespérée, car je pense que l’identité, ou mieux devrait-on dire l’ispéité, ou peut-être même l’eccéité, n’existe qu’à l’état d’horizon à atteindre qui non seulement s’éloigne mais se transforme à mesure que l’on avance. Nous l’avions aussi nommée, en donnant à la racine « éco » tout son sens, « econumia identitaria » ? Mais quel que soit le nom qu’on lui donne, c’est elle qui nous met tant comme individu que comme corps social (nazione ?) en mouvement. C’est donc le vrai moteur du futur PADDUC. Car il fut un temps, pas si lointain, où ce que certains nomment aujourd’hui à tort l’identité n’était qu’un ensemble de comportements rémanents, d’un autre temps, d’autres mœurs, immobilisés par l’histoire, en quelque sorte encalminé.
Jean-Michel Sorba
C’est en effet la société civile qui semble la plus agile sur le front du changement, notamment le mouvement associatif. Les entreprises de par leur faible taille cherchent à se conformer aux règlements plutôt qu’à s’engager dans un processus de changement social intégrant les transitions écologiques. L’écotourisme est en retard et demeure essentiellement cosmétique. Les acteurs perçoivent aujourd’hui l’inaction de l’Etat et savent que leur conditions d’existence est en partie dans leurs mains.
Plusieurs cadres de pensée comme le biorégionalisme ou l’écologie territoriale à l’usu corsu commencent à prendre forme, des innovations sociales sont expérimentées localement. Larrère nous enjoint à poursuivre ce cap : « les réponses robustes au dérèglement climatique et écologique ne s’élaborent pas au niveau global, qui est plutôt celui de l’effroi que de l’action, elles se manifestent là où le global est localisé, là où les citoyens ordinaires se mobilisent pour défendre leur milieu de vie et explorer les chemins d’un monde plus démocratique ». De là, la nécessité de concevoir une organisation démocratique capable de penser et de réaliser les deux exercices, planifier et participer (délibérer) localement...une forme de planification participative ! Un Padduc repris dans le terreau des dynamiques locales !
[1] Catherine Larrère est philosophe, professeur émérite à l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne et spécialiste de philosophie morale et politique.